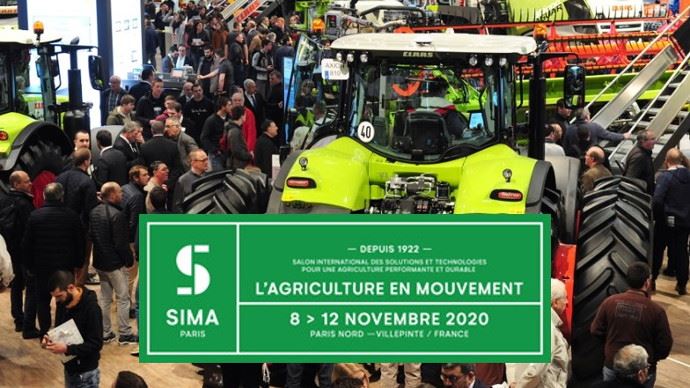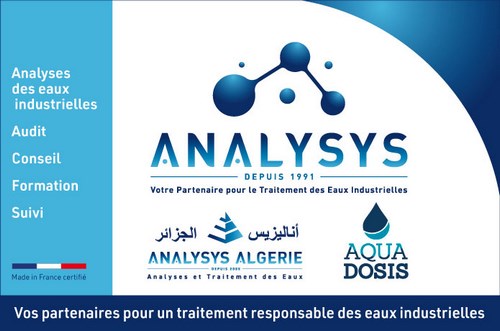Selon Arezki Chenane, spécialiste des questions du développement territorial durable, il y a lieu de faire un diagnostic détaillé des disponibilités foncières avant d’assurer un arbitrage entre les urgences et les priorités des projets. Et ce, pour trouver des solutions alternatives dans le contexte de la durabilité.
Ces dernières années, de nombreuses décisions ont porté sur le déclassement des terres agricoles au profit notamment de projets urbains. Quel a été l’impact sur la déperdition du foncier agricole, mais également sur la dynamique du développement durable ?
Souvent, les politiques de développement initiées par l’Etat se heurtent à des exigences socio-économiques stratégiques demandant leur adaptation.
C’est le cas justement de notre pays. Ces dernières années, beaucoup de projets d’équipement publics (programmes de logements, pôles urbains, stations de dessalement, stations d’électricité et de gaz, structures sanitaires et éducatives…), contenus dans les orientations du Schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) à l’horizon 2035, souffrent de manque d’espaces devant les recevoir, en raison de la spécialisation du foncier. C’est ainsi qu’il a été procédé au déclassement des terres agricoles pour pouvoir concrétiser ces projets d’utilité publique, et ce, au nom de l’impératif du développement «non maîtrisé» en raison des besoins socio-économiques sans cesse croissants.
Cependant, ce déclassement a touché des EAC et des EAI concernant plusieurs wilayas du pays en réduisant considérablement la surface agricole utile (SAU), qui est de 8,5 millions d’hectares. En référence justement aux différents décrets exécutifs régissant ces déclassements parus au JORADP du 9 octobre 2024, nous enregistrons une surface agricole déclassée estimée à près de 1677 hectares (cf. DE n° 24-316, DE n° 317 et DE n° 318 du 29 septembre 2024 portant déclassement des terres agricoles de certaines wilayas). Cette situation est à l’origine de la déperdition du foncier agricole, causant inévitablement un déséquilibre en activités économiques. Ce qui risque d’induire des externalités négatives en termes de développement durable. Et ce, en sus de leur utilité publique attendue, bien entendu (pollutions, déchets et dégradation de la biodiversité et du couvert végétal) qu’il faut gérer dans le cadre surtout des changements climatiques et toute forme de dégradation écologique. De même, cette situation conduirait à réduire la sécurité alimentaire. Je dirais que nous devrions revoir de manière rationnelle cette stratégie, en engageant des études appropriées pour protéger ces surfaces agricoles, tout en tentant de réaliser un développement écologiquement sain, économiquement viable et socialement équitable, de manière à ne pas compromettre les besoins des générations futures.
Qu’attendre de la décision du chef de l’Etat dans ce cadre ?
A la lumière des décisions du Conseil des ministres du 5 octobre 2025, le président de la République a refusé que des terres agricoles soient détournées de leur vocation. C’est ainsi qu’il faut aller, pour la mise en place des projets d’équipements publics, à utiliser des terres non arables. A mon avis, de cette décision découlerait inévitablement un plan d’action adapté au contexte de chaque espace concerné par les projets initialement inscrits sur ces terres agricoles. Pour se faire, un diagnostic de la situation est à opérer, dans un premier temps un arbitrage entre les urgences et les priorités des projets pour trouver des solutions alternatives dans le contexte de la durabilité.
Dans ce cadre, il est nécessaire de réadapter les instruments d’urbanisme à cette nouvelle donne, dans la perspective de révision du SNAT dans ses plans d’action.
Quelles sont les actions à prioriser dans ce cadre ?
Je pense qu’il est nécessaire d’actualiser les orientations du Snat pour que ses déclinaisons locales du PDAU (plan directeur d’aménagement et d’urbanisme) et du POS (plan d’occupation de sol) réduisent les incohérences. Je trouve une aberration à titre d’exemple de faire un cimetière intercommunal sur des terres agricoles. Juste un exemple. Il s’agit en effet de prendre en charge la problématique de la non-articulation des instruments du SNAT par rapport aux plans d’action territoriaux. Car, l’attractivité des territoires n’est pas reliée tout à fait à la durabilité. D’où la nécessité de prendre en considération les spécificités locales et régionales dans la mise en oeuvre des projets publics de développement.
La commune doit être aussi au centre des actions à entreprendre. Il s’agit par ailleurs de développer l’intercommunalité pour réduire les coûts et mutualiser les ressources dans le contexte de la contrainte foncière.
Comment concilier, à votre avis, développement durable, préservation des terres et développement économique ?
C’est une problématique de taille, du fait qu’il existe des projets nécessitant leur réalisation, comme par exemple les stations de dessalement de l’eau de mer pouvant réduire le stress hydrique et assurer la sécurité hydrique, qui constituent un impératif dans le contexte du développement durable du fait de l’utilisation d’une ressource inépuisable.
D’autres projets doivent être réalisés en préservant les terres agricoles, particulièrement par la mise en place des techniques d’urbanisme innovantes, telles que la construction verticale et souterraine pour une utilisation optimale du foncier disponible. Ces techniques reposent sur l’utilisation des matériaux moins coûteux avec plus de sécurité. Beaucoup de pays y recourent, comme le Japon, la Finlande, l’Arabie Saoudite...
Ces mesures, à mon avis, peuvent permettre la maîtrise du processus de l’urbanisation effrénée pour répondre à des urgences et impératifs sociaux en matière du logement particulièrement.
Quid des disponibilités financières à assurer ?
En matière de financements de cette question de la préservation des terres agricoles, il va falloir penser à mobiliser des fonds où tous les secteurs vont contribuer de manière efficace et durable pour arrêter ce déséquilibre. Ce dernier génère surtout des dérèglements climatiques qu’il faut atténuer de manière à développer des activités moins polluantes et durables, dans la cadre des plans climat locaux. Lesquels s’inscrivent dans le cadre de la gouvernance climatique, telle que décrite par les COP (conférences des parties) relatives à la lutte contre les changements climatiques. De ce fait, les plans climat locaux doivent être articulés autour de l’urbanisme durable en mettant en place des financements internationaux dédiés à cette problématique.
Bio-Express
Arezki Chenane, professeur de l’enseignement supérieur et enseignent chercheur à l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, est titulaire d’un doctorat en sciences économiques. Spécialiste des questions du développement territorial durable, il a son actif plusieurs publications scientifiques nationales et internationales. Il est également fortement impliqué dans des projets de recherche-action.
Source:https://elwatan-dz.com/
Entretien réalisé par Samira Imadalou